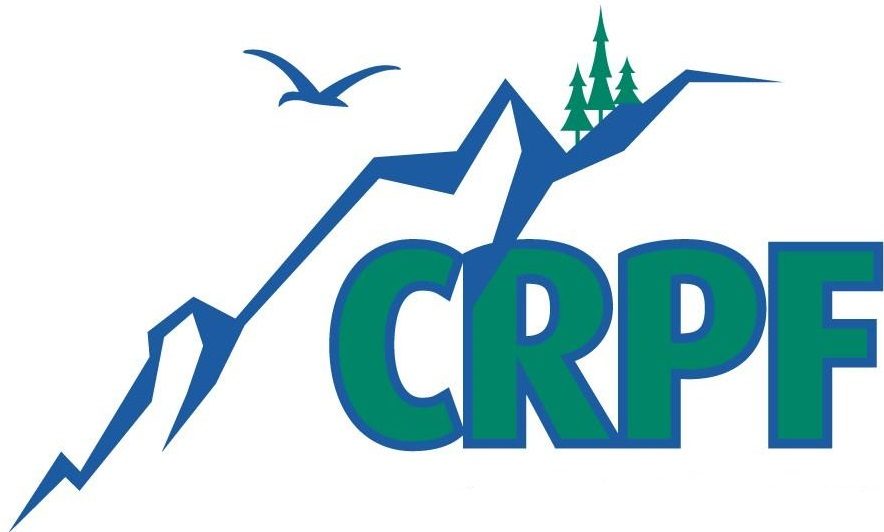par Diane Barriault
Picea glauca
L’épinette blanche atteint 20 à 25 mètres de hauteur et croît dans tous les types de sols, même sur des terrains rocheux où la couche végétale est mince. De silhouette conique à la cime plutôt large, l’épinette blanche porte de nombreux cônes cylindriques qui pendent des branches et se détachent en entier chaque année. Cette espèce présente les aiguilles les plus longues. Son bois est utilisé en menuiserie et en charpenterie et dans une moindre mesure dans l’industrie de la pâte à papier. C’est avec les radicelles de cette espèce que les Amérindiens cousaient l’écorce de bouleau dans la fabrication des canots.
Picea rubens
L’épinette rouge est plus répandue dans les provinces maritimes et, même si on en trouve dans nos régions, elle est peu abondante. De taille et de port semblable à l’épinette blanche, elle s’en distingue notamment par ses rameaux couverts de poils (les rameaux de l’épinette blanche sont glabres) et son écorce brun rougeâtre et effilochée (celle de l’épinette blanche est grise et écailleuse). Le bois de l’épinette rouge sert à la fabrication d’instruments à cordes tels le violon et la guitare.
Picea mariana
L’épinette noire règne sur tout le territoire nordique du Québec, particulièrement en Abitibi, où elle est l’essence dominante de la forêt. Dans nos régions, on trouve plutôt des individus isolés colonisant des tourbières. Dans ces conditions, l’épinette noire est un petit arbre atteignant 20 mètres de hauteur au port étroit et effilé et aux branches principales courtes comparativement aux autres épinettes. Ses rameaux sont densément couverts de poils. Sa cime très dense forme un renflement portant de nombreux cônes, lesquels persistent plusieurs années sur l’arbre. Le bois léger, mou et faible de cette espèce est peu recherché en charpenterie, par contre sa fibre est excellente pour la fabrication de pâte à papier.